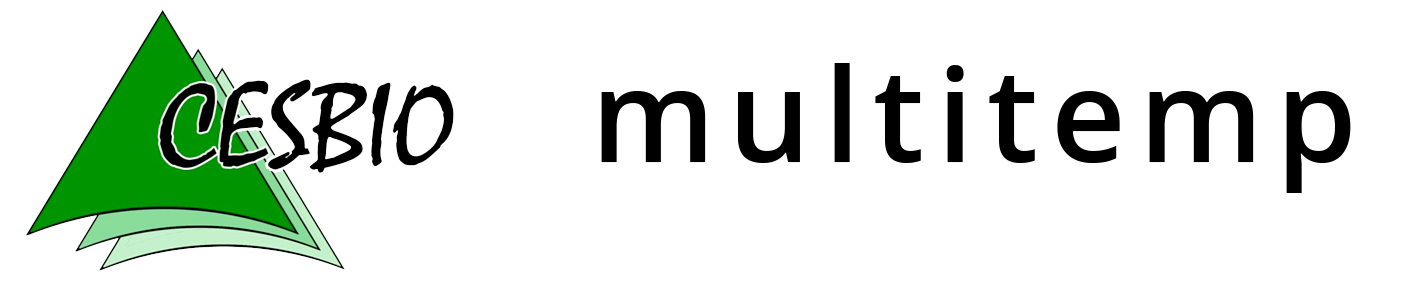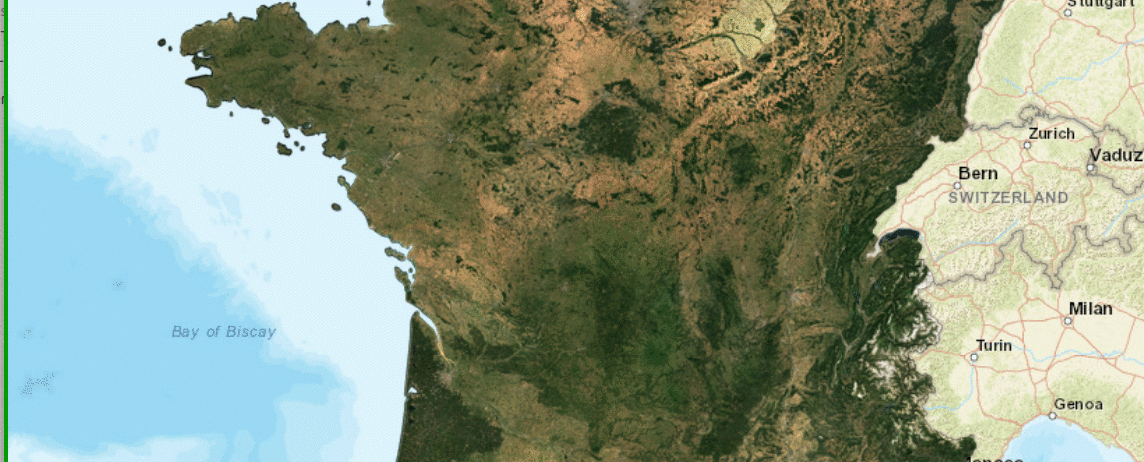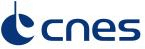Orpaillage sur le fleuve frontalier entre la Guyane et le Suriname : télédétection des dommages causés par les barges aux rives du Maroni
Le Suriname, comme l’ensemble du plateau des Guyanes, est touché depuis plus de trente ans par le fléau de l’orpaillage qui entraîne la destruction du couvert forestier, la pollution des cours d’eau, en impactant fortement l’environnement et les population locales. L’orpaillage y est dit primaire quand l’or est directement extrait de la roche-mère, alors qu’il est alluvionnaire quand il est exploité dans le lit des cours d’eau.
Le second type est le plus répandu au Suriname, où il prend une forme particulière dans les fleuves et rivières de taille importante. Des barges, véritables mini-usines flottantes, draguent les sédiments du fond des cours d’eau qui passent ensuite sur une série de rampes de lavage pour en extraire un concentré aurifère. L’or est finalement extrait par amalgame avec le mercure, hautement toxique (environ 1,5kg par kg d’or). Outre cette pollution, le procédé est particulièrement dévastateur pour les cours d’eau dans lesquels il rejette de grandes quantités d’eau boueuse qui nuisent à la flore et la faune aquatique. Les populations locales sont également directement touchées par cette pollution, le fleuve constituant leur bassin de vie, où elles s’y nourrissent et s’y lavent.

Ces barges, interdites en Guyane mais pas au Suriname, font régulièrement polémique sur le Maroni, fleuve transfrontalier entre les deux territoires. Depuis début 2019, on assiste à un nouveau développement de cette pratique qui s’attaque désormais aux rives surinamaises. Celles-ci normalement recouvertes de forêt, sont défrichées et la couche supérieure du sol est arasée à la pelle mécanique. Les barges entrent ensuite en action depuis le fleuve en creusant la terre des berges à la recherche d’or. En plus des boues toujours rejetées dans le fleuve en grandes quantités, cette pratique entraine le déboisement et l’affaissement des rives et les rend vulnérables à l’érosion dans une région où la pluviométrie est très importante. C’est ainsi le lit même du cours d’eau qui s’en trouve fortement modifié par endroits.

Cette pratique est visible en quasi temps-réel grâce à la méthode de détection de la déforestation de Bouvet et al. 2018 et décrite ici. Cette méthode, basée sur les images Sentinel-1, est particulièrement pertinente dans cette région où la couverture nuageuse importante limite les systèmes de surveillance optique (voir l’évaluation ici).

Comme on peut le voir sur cette animation, plusieurs chantiers de ce type se sont développés en 2019 entre Maripasoula et Papaïchton (environ 25 km de fleuve). Les barges attaquent les rives et creusent de véritables chenaux sur plusieurs dizaines de mètres. Sur cette seule zone, on estime une perte de plus de 36.7 ha de forêt seulement en 2019 !
Ces pratiques, régulièrement dénoncées par les autorités françaises et les organisations locales, dont le WWF Guyane, devraient finalement disparaître à terme. Le nouveau gouvernement surinamais s’est en effet récemment engagé dans un accord de coopération avec la France, à ne pas délivrer de nouvelles licences d’exploitations pour ces usines flottantes et ne plus renouveler celles arrivant à expiration. Un pas en avant pour le fleuve Maroni et ses habitants si cet accord est effectivement respecté. Le suivi précis que l’on peut faire grâce à Sentinel-1 permettra de voir si ces annonces sont suivies d’effets.